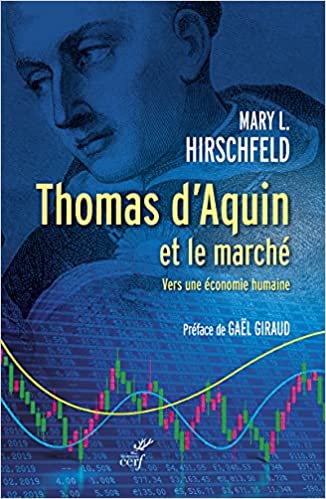GRAATOn-Line
Gender Studies & Cultural Studies. Estudios de género & Estudios culturales. Études sur le genre & Études culturelles.
GRAAT On-Line - Book Reviews
Mary L. Hirschfeld, Thomas d'Aquin et le marché. Vers une économie humaine,, (traduit de l'anglais par Jacques-Benoît Rauscher, préface de Gaël Giraud, Paris : éditions du Cerf, 2021). 24.00e, 392 pages, ISBN : 9782204141536, 392 pages — Bruno Hueber, Université de Tours.
Quoique, certes, très différentes par leurs modalités de connaissance et d'objet, la théologie et l'économie ont peut-être, très involontairement assurément, ceci de commun qu'elles ne laissent pas d'interroger, non pas seulement sur ce que peut et doit être une “science” en général pour pouvoir se prétendre telle, mais plus précisément sur l'étanchéité possible et souhaitable entre le gnoséologique ou l'explicatif, voire le prédictif, d'une part, et l'axiologique, le normatif ou le prescriptif, d'autre part. En l'espèce, et l'ouvrage de Mary Hirschfeld que nous regardons ici l'expose-t-il clairement, autant la théologie, qui se pose comme “science du divin”, assume pleinement le lien entre l'ontologie et l'éthique, entre la transcendance et le prescriptif, en affirmant l'objectivité des valeurs, en posant une vision nette et parfaitement assumée de l'homme, comme imago dei, de ce qu'il peut et de ce qu'il doit être, par-delà ce qu'il peut vouloir, désirer ou ressentir sur le moment [193-195, 214, 339-340, 351-358, 376], autant l'économie, que l'on définira comme la science de la production et de l'allocation de ressources nécessairement rares (des biens matériels aux biens symboliques, en passant par les biens affectifs) entre des fins nécessairement concurrentes [89, 93, 133], au nom de sa rigueur, de sa rationalité, de la mathématisation de droit de son objet revendiquées, gage ainsi de prédictions soi-disant efficaces, fille modèle du paradigme de la scientificité webérienne, autant cette économie donc, disons-nous, a-t-elle tendance à vouloir et prétendre refouler hors de sa discipline tout ce qui pourrait sembler normatif. Au risque de s'exposer d'autant mieux ainsi, par un manque de réflexivité assez flagrant, voire quelque peu suspect, à être la victime de ses propres abstractions, prétentions, et représentations implicites, ignorant les limites de l'anthropologie qui structure son champ de compétence. Reste à savoir, par voie de conséquence, si cette prétention à être indemne de toute injonction, de toute morale en somme, est bien fondée ou possible, dès lors que l'on n'a de cesse d'énoncer ou de faire jouer, ou de présupposer une certaine idée l'homme. Ce qui semble au fond assez peu probable. Reste alors à savoir bien sûr, subséquemment, en amont, ce qu'il en est de cette vision de l'homme que nous propose le modèle mainstream de la science économique, et si elle est autre chose qu'un pur artefact, l'objet idéal et fantasmé d'une science qui y trouverait là, par un effet de circularité ou cercle vicieux, ni plus ni moins que la caution de ses prétentions descriptives et prédictives.
Et, au fond, de quoi s'agit-il, dans cet ouvrage, précisément, que de montrer qu'aucune “science”, et l'économie peut-être encore moins qu'une autre, dès lors qu'elle touche à l'homme, ne peut s'exonérer d'hypothèses métaphysiques ou se croire indemne de valeurs et de normes, et que dès lors qu'elle prétend fonctionner avec des “évidences,” pour ce qui est de la nature de l'homme et de ses motivations, le fameux modèle du “choix rationnel”, mérite-t-elle un examen plus attentif qu'elle ne le croit ou ne le souhaite parfois. Car pour ce qui est en l'occurrence de l'économie, les implications de sa vision de l'homme et du collectif ne laissent pas d'être pour le moins des plus inquiétantes. Qu'il s'agisse de l'injustice qu'elle peut cautionner (le creusement systémique des inégalités économiques et sociales, fût-ce en démocratie), qu'il s'agisse des catastrophes environnementales découlant du dogme d'une croissance indéfinie (réchauffement climatique, pollution et épuisement des sols et des nappes phréatiques), qu'il s'agisse enfin du vide existentiel qu'elle initie sourdement par le délitement éthique qu'elle suscite (égoïsme, consumérisme, et marchandisation de toute chose), notre modernité butte suffisamment sur ces multiples et diverses externalités pour ne pas en venir à s'interroger sur les présupposée ou le paradigme qui nous demandent de les accepter comme une nécessité inexorable, qui ne serait alors amendable que de façon très marginale. Au point, d'ailleurs, qu'aux yeux de certains, n'est-il aucunement absurde de prétendre que cette science économique n'est que trop bien taillée sur mesure pour ne pas être seulement avant tout qu'un programme de justification ou de propagande du capitalisme ou néo-libéralisme [37, 76-77, 87-88, 79].
Et, au fond, de quoi s'agit-il, dans cet ouvrage, précisément, que de montrer qu'aucune “science”, et l'économie peut-être encore moins qu'une autre, dès lors qu'elle touche à l'homme, ne peut s'exonérer d'hypothèses métaphysiques ou se croire indemne de valeurs et de normes, et que dès lors qu'elle prétend fonctionner avec des “évidences,” pour ce qui est de la nature de l'homme et de ses motivations, le fameux modèle du “choix rationnel”, mérite-t-elle un examen plus attentif qu'elle ne le croit ou ne le souhaite parfois. Car pour ce qui est en l'occurrence de l'économie, les implications de sa vision de l'homme et du collectif ne laissent pas d'être pour le moins des plus inquiétantes. Qu'il s'agisse de l'injustice qu'elle peut cautionner (le creusement systémique des inégalités économiques et sociales, fût-ce en démocratie), qu'il s'agisse des catastrophes environnementales découlant du dogme d'une croissance indéfinie (réchauffement climatique, pollution et épuisement des sols et des nappes phréatiques), qu'il s'agisse enfin du vide existentiel qu'elle initie sourdement par le délitement éthique qu'elle suscite (égoïsme, consumérisme, et marchandisation de toute chose), notre modernité butte suffisamment sur ces multiples et diverses externalités pour ne pas en venir à s'interroger sur les présupposée ou le paradigme qui nous demandent de les accepter comme une nécessité inexorable, qui ne serait alors amendable que de façon très marginale. Au point, d'ailleurs, qu'aux yeux de certains, n'est-il aucunement absurde de prétendre que cette science économique n'est que trop bien taillée sur mesure pour ne pas être seulement avant tout qu'un programme de justification ou de propagande du capitalisme ou néo-libéralisme [37, 76-77, 87-88, 79].
Certes, à deviner, à la simple lecture de son titre, le propos de l'ouvrage de M. Hirschfeld, titulaire d'un double doctorat en économie et en théologie, Aristote (IVe siècle av. J.-C.), aurait-il pu déjà être un contrepoint suffisant aux évidences morales dispensées de fait par le modèle dominant en économie. Sa vision de l'homme, dont le bonheur s'organise autour de la médiété, de la contemplation, de l'amitié ou de la participation politique, bien loin de la chrématistique (art d'acquérir, et de s'enrichir par la monnaie) ou de la pléonexie (la passion du “toujours plus”) sécrétées par notre société, nous donnait déjà une alternative pour le moins claire et cohérée. Soit. Mais il se trouve seulement que pour notre autrice, s'agit-il, au premier chef, de s'adresser aux chrétiens eux-mêmes, et de montrer en quoi la profondeur de l'œuvre de l'Aquinate, en y intégrant la Révélation, mais aussi bien une réelle sensibilité aux prodromes d'une économie de marché, se révèle au fond plus opératoire que celle du Stagirite, dès lors qu'il s'agit d'éclairer leur action dans le monde d'aujourd'hui. C'est que, faut-il y insister, Thomas d'Aquin, pour docteur de l'Eglise qu'il soit, ne déploie-t-il en rien une approche ascétique ou désincarnée de la Doctrine. N'étant ni un zélateur du sacrifice, du martyre, de l'oubli de soi, non plus que le contempteur de l'intérêt personnel ou d'un moi “haïssable", non plus que l'ennemi de la propriété privée, loin de là, ni un détracteur définitif du commerce et du travail (si nécessaire pour assurer les échanges, pour ce qui est du premier, et pour éviter l'oisiveté, pour ce qui est du second), allant même jusqu'à faire des biens matériels et de leur satisfaction un reflet de Dieu et de sa bonté. [191, 80-83, 266-270], il se trouve que son œuvre, avec celles de Duns Scott ou Guillaume d'Occam, n'est assurément absolument pas déconnectée des problèmes éthiques de l'économie de son temps. En l'espèce, et en marge du livre de M. Hirschfeld, peut-on ici faire référence, en France, pour ce qui est de ce contexte bien présent, pour ne pas dire prégnant, de la Somme Théologique, aux travaux et publications, parmi d'autres, de Gérard Sivéry, Geneviève Médevielle, Sandrine Frémeaux, Christine Noël-Lemaître ou Antoine Barlier.
Mais s'inspirer d'un théologien, pour éclairer et réguler le marché d'aujourd'hui, est une chose, encore faut-il préciser plus finement les rapports que l'on prétend pouvoir établir ainsi entre théologie et économie. Et de fait, reprenant pour une grande part à son compte une étude de Duane Stephen Long (né en 1960), Mary Hirschfeld, distingue alors trois attitudes ou postures possibles.
La première [47-52], consiste pour la théologie à accepter a priori la tradition économique qu'elle trouve devant elle, qu'elle soit capitaliste (Michael Novak, Max Stackhouse, Dennis McCann, Philip Wogaman, etc.) ou hétérodoxe (néo-marxiste, post-keynésienne, ou féministe), avec pour cette dernière des figures comme James Cone, Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino, ou Rosemary Radford Ruether. Ce qui se traduit par le fait qu'elle ratifie alors, sans réserve, le triptyque conceptuel “économiste” dominant : à savoir d'une part la neutralité axiologique prétendue de ladite science économique, d'autre part la représentation d'un homme qui crée et décide, par ses choix, de la valeur des choses, et enfin l'importance de la représentation de l'involontaire collectif, comme conclusion et résultat plus ou moins satisfaisant de l'agrégation des préférences ou choix individuels. A charge en suite, pour elle, de s'adapter, vaille que vaille, pour ne pas dire de bric et de broc, à ce donné considéré à tout prendre comme aussi infrangible que les Tables de la Loi, ou les lois de la Nature.
La seconde approche [52-59], au demeurant possiblement entérinée par l'Eglise catholique elle-même, serait non plus une acceptation, mais bien plutôt une contiguïté ou une division du travail, chacune délimitant un domaine de compétences particulier. Et comme de bien entendu, les théologiens auraient-ils pour tâche l'identification des fins (la dignité ou la solidarité par exemple), les économistes, eux, les programmes, les plans et les politiques à même d'atteindre ces fins. Cette position, remarquons-le, peut alors aussi parfaitement rencontrer l'adhésion des économistes : ceux-ci y voyant alors implicitement la caution de leur rigueur épistémologique indemne de toute approche normative. Or, et c'est là un point qu'il faut souligner pour comprendre le sens de l'ouvrage, cette position, pour Mary Hirschfeld, présente le redoutable double défaut de vider la théologie de toute pertinence économique véritable et de laisser en fait trop en paix les théories économiques avec leurs présupposés ou évidences anthropologiques sur lesquels elles peuvent bâtir ensuite leurs pratiques ou leurs prévisions et innerver qui plus est les politiques publiques.
La troisième et dernière approche [59-67], (la “tradition résiduelle” selon Long) qui renvoie à des personnalités comme Bernard Dempsey, Alasdair MacIntyre ou John Milbank, se veut-elle, pour son compte, plus incisive, en proposant donc, non pas seulement une axiologie fermement objectiviste, posant un ordre de valeurs qui excèdent, précédent les volontés, les désirs de l'homme et des peuples aussi “souverains' qu'ils puissent être, ou le jeu du marché lui-même, mais bien davantage encore une anthropologie alternative à celle qui sous-tend, volens nolens, peu ou prou, la théorie économique dominante. Et à tout prendre, la position de notre autrice est-elle assez simple. Ratifiant cette “tradition résiduelle” ne s'agira-t-il pas de critiquer frontalement a priori l'économie d'aujourd'hui, ni d'opposer pensée économique et tradition ascétique, mais d'une part de repérer les dogmes implicites de ce modèle économique dominant, d'autre part d'exposer la pensée théologique de Thomas d'Aquin, comme étant une autre vision des fins et du bonheur de l'homme, ni plus ni moins absurde, arbitraire ou réductrice qu'une autre, aussi scientifique pût-il se prétendre. Nous voici bien alors de plein pied enfin dans le projet d'une “économie théologique”.
Mais est-il plus que temps ici, de préciser aussi sommairement que ce soit, ce qu'il en est de ce “choix rationnel” dont on peut, selon elle, faire le paradigme hégémonique de l'économie d'aujourd'hui.
Or, somme toute, les points saillants de ce modèle ne sont-ils guère difficiles à recenser. Et la première caractéristique de celui-ci est-il qu'il est précisément un modèle, une simplification donc qui prétend précisément ramener en l'occurrence l'ensemble des comportements à une même motivation, pour mieux satisfaire sans doute à l'ambition de formalisation ou de mathématisation. Or nul n'ignore qu'à vouloir simplifier la réalité humaine, risque-t-on assez facilement de glisser vers des cécités aux conséquences parfois dramatiques, à tous points de vue. C'est que si le mot “culture” est autre chose que le mot-valise pour fonctionnaires de l'Unesco, politiciens à recycler, ou chroniqueurs en mal de cocktails et de places réservées, désigne-t-il, bien plus sérieusement, la capacité pour un sujet à modifier, infléchir, réinitialiser la qualité de sa relation, ou à voir sa motivation se bouleverser en fonction de ce avec quoi il prétend espérer pouvoir établir une interaction, aussi asymétrique qu'elle soit. Or, dans le cadre du modèle quantitativiste qui nous occupe ici, que l'on parle de pétrole, de chocolat, de mariage, ou même de religion, l'important est-il que toutes les différences qualitatives des volitions humaines puissent rentrer dans un seul et même cadre motivationnel explicatif et qualifié ipso facto de “rationnel” : “intérêt", “utilité", ou “satisfaction”. Voilà le triomphe d'une mesure “uni-variée” assurant par conséquence une vision unitaire de la raison pratique [119]. Pensera-t-on ici, pour exemple emblématique de ce réductionnisme, à l'œuvre du prix Nobel Gary Becker (1930-2014), laissant clairement entendre que “toutes choses égales par ailleurs”, Bernard Madoff (1938-2021), financier et escroc s'il en est, mort en prison, et mère Teresa (1910-1997), prix Nobel de la paix et canonisée par Rome, ne cherchaient tous deux qu'à maximaliser leur fonction d'utilité, l'altruisme n'étant alors qu'une utilité ou préférence comme une autre, et sans qu'il soit pertinent d'un point de vue scientifique de les distinguer moralement [17-18, 99, 120-121, 225, 345-349, 355, 372-373]. De quoi, pour un peu, donner raison au philosophe Michel Henry (1922-2002) qui en son temps voulait voir la science comme la barbarie sournoise des temps modernes, obsédée par ses généralités et sa volonté de tout quantifier, ne sachant que trop bien nous rendre oublieux ou aveugles à l'endroit de la réalité humaine en sa complexité éthique essentielle.
Cela étant, et est-ce bien là le signe que la science économique “bouge encore”, l'autrice ne laisse-t-elle pas de rappeler aussi que tous les économistes, non seulement peuvent-ils ne pas se leurrer sur la pertinence d'une telle abstraction ou réduction, mais sont-ils aussi capables de remettre en cause la prétendue ou nécessaire disjonction du descriptif et du normatif. N'est-il, pour s'en convaincre, que de citer ainsi le contre-exemple rafraichissant de l'œuvre d'un autre prix Nobel, Amartya Sen (né en 1933), qui non seulement s'interroge ainsi sur le bien-fondé d'une telle scission entre l'éthique et l'économie, mais insiste tout autant sur la diversité qualitative irréductible des motivations (“bien-être,” “engagement” ou “compassion”) [37, 119-127,157].
La deuxième caractéristique qui se dégage sans doute des critiques prudentes de Mary Hirschfeld est que l'individu est invité ainsi plus concrètement à se penser comme ne cherchant qu'à maximiser la somme de ses satisfactions, comme habité d'un désir infini qui ne serait en fait qu'une addition hétéroclite de demandes, issues elles-mêmes d'incitations et stimulations diverses, sans cohérence ni ordonnancement. Plus encore : non seulement y a-t-il uniformisation des motivations, mais, qui plus est, réduction à celle que l'on qualifiera ici pour aller vite de consumériste, pour signifier ce qu'elle suppose du sujet et encourage comme attitude en celui-ci. L'homme ne vise qu'à satisfaire les préférences qu'il a commencées par poser comme telles [94, 131]. Point de service, point de sacrifice, point d'enthousiasme désintéressé, point de “grandeur" : non, l'homme appréhendé comme n'étant foncièrement qu'un “consommateur” en ses motivations, décidant par son appétence de la valeur des choses, ne peut que n'avoir de cesse d'optimiser ses préférences qu'ils affectionnent d'autant plus qu'elles sont les “siennes”. Du moins, le croit-il, et fait-on tout pour qu'il le croie. Voici donc la structure de base véritable de ce que l'on appelle matérialisme, son intentionnalité : un sujet qui se pense comme souverain, pour ne pas dire prédateur, et qui récuse toute transcendance dans la relation qu'il initie aux choses et aux êtres, quels qu'ils soient : fût-ce, au demeurant, Dieu lui-même. Un Dieu qui hante sans doute les formes modernes de religiosité, et qui n'a sans doute en fait, quoi que portant le même nom, que très peu à voir avec celui que priait Saint Augustin ou Sainte Thérèse d'Avila. Un Dieu, devenu, d'un point de vue psychologique, rien d'autre qu'un simple prestataire de services, plus ou moins fiable et joignable à tout heure, et censément une garantie d'émotions distinguées, dès lors qu'il est invoqué, sollicité, pour ne pas dire convoqué de bonne façon. Et est-ce bien là, cette représentation consumériste et hédoniste du sujet sur lequel repose en fait le capitalisme au travers de sa catallaxie ou promotion du marché, instance ultime de répartition des biens et d'attribution des valeurs, diluant toute spécificité intentionnelle au profit de celle du choix de la décision de chacun. De l'économisme au capitalisme, et du capitalisme au consumérisme, la chaîne éthique est cohérente, aussi religieuse que soit l'origine, ainsi que Max Weber a pu l'établir, de ce même capitalisme. Nul besoin, cela étant, d'être théologien pour pointer effectivement le matérialisme foncier de celui-ci. Et notre autrice d'évoquer ici aussi bien Herbert Marcuse que John Kenneth Galbraith ou Thomas Piketty [32].
La troisième et dernière caractéristique de cette représentation de l'homme, consommateur souverain, est ce qui fonde et légitime le programme “évident” d'une croissance économique indéfinie, quelle qu'en soit son coût et ses conséquences réels, à court, moyen, ou long terme sur l'homme mais aussi l'ensemble de son environnement [132-140]. Le bonheur de l'homme dépendrait, non pas seulement en ses bases, mais foncièrement, définitivement, absolument du type de richesses que la science économique prétend savoir développer. Celle-ci peut-elle alors pleinement prétendre clore la question de l'éthique, dans le temps même où la notion d'anthropocène prend-elle ainsi toute sa signification dramatique, de par l'aspect irrationnel, irréaliste et fatal de ce qui est adoubé obstinément avec toutes les rhétoriques nécessaires, comme “progrès” quels qu'en soient les effets collatéraux : l'exploitation systématique de la planète, l'épuisement des ressources ainsi que des modifications irréversibles de l'environnement.
Ce modèle exposé en sa dogmatique la plus saillante, quelle alternative serait censément susceptible de nous proposer la pensée de Saint Thomas ? Du moins, ajoutons-nous, à l'aune de la lecture que veut en faire M. Hirschfeld reconnaissant elle-même qu'elle n'est pas la seule possibilité. Au demeurant est-ce bien ainsi que veut l'entendre, avec la cautèle typique de son ordre, Gaël Giraud, jésuite de son état, donc, et qui dans une préface, très peu nécessaire, à l'édition française, ne rend hommage à l'ouvrage que pour mieux susurrer que son autrice ne détient assurément pas la fin ni le bon mot de l'histoire en matière d'exégèse thomiste.
Toujours est-il qu'il s'agit ici d'affirmer ni plus ni moins, que l'homo œconomicus réel n'est pas nécessairement l'homo avidus, qu'il y a des biens et des motivations incommensurables contrairement à ce qu'un excès d'abstraction voudrait laisser entendre, [78,199], que tout n'est donc pas marchandisable (comme le dirait certes aussi bien le “laïc” Michaël Sandel), que le bien-être n'est pas la même chose que la satisfaction des préférences, et que l'homme est appelée à une fin, dès ici-bas, qui excède ce qu'il veut penser comme “projet de vie personnel”. Plutôt que de satisfaction pourrait-on même parler, avant une fin ultime hors de ce monde, de perfection ici-bas, résidant dans l'articulation de ces vertus fondamentales héritées d'ailleurs de l'antiquité grecque (tempérance prudence, justice et courage) : la vertu donc, au sens aristotélicien (arété), signifiant davantage l'excellence, l'accomplissement, la réalisation de sa nature, que l'effort pénible dans l'accomplissement de la loi morale [192-206]. Penser une économie véritablement humaine par le recours à une transcendance qui pose une vision claire de l'homme et de ses fins, et possiblement et a contrario, de son aliénation, voilà au fond l'enjeu ou l'intitulé exact du débat [378-379].
Peut-on en dire davantage, sans trop entrer dans les détails ? Esquissons ici, à marche forcée, quelques indications. Par le terme de justice [289-335], doit-on entendre donc autre chose que ce qui résulte de l'offre et de le demande en matière de biens ou d'interactions sociales. Ce qui ne laisse pas d'avoir des conséquences pour ce qu'il en est de la valeur ou des limites de la propriété privée. Car pour pleinement légitime qu'elle soit, loin donc de n'être que la rançon du péché, ne saurait-elle devenir l'ennemie du bien commun ou interdire que tel ou tel puisse accéder de façon pacifique au nécessaire. Dit plus clairement encore, n'est-il ainsi pas question d'imaginer que la doctrine de la propriété privée puisse légitimer que la surabondance de l'un puisse priver de l'indispensable et encore moins du vital un autre. Si cette situation se présente, pour Saint Thomas, (Somme Théologique, IIaIIae, q. 66) n'y a-t-il alors “ni vol, ni rapine, à proprement parler” [301]. D'où l'extrême importance de distinguer, chez l'Aquinate, le nécessaire, aussi lié qu'il soit à un “statut social”, de l'excès, de la surabondance ou du luxe. Précisions que le travail lui-même, ne saurait-il sanctuariser la propriété privée. Bref, la valeur de celle-ci ne saurait donc être autre qu'instrumentale, au service d'un ordonnancement des biens matériels visant un véritable bien commun.
Et ce n'est, inversement, faut-il ajouter, que par la délimitation de ce même nécessaire, qui ne se réduit pas assurément au vital, qu'il peut être donné d'élaborer une pensée très raisonnée, pour ne pas dire, raisonnable, d'une aumône ou d'une charité, n'ayant certes pas vocation à s'inscrire dans le sacrifice de soi ou à s'exprimer au détriment du donateur [337].
En outre, corollaire d'une affirmation métaphysique, l'homme thomiste, imago dei, se voit attribuer une nature spécifique, à côté de celle, qu'il peut partager, quasi-rationnelle, avec les animaux, et faisant de lui un être véritablement moral [144-155]. Une nature qui est une rationalité autre, à même d'ordonner les volontés, de les hiérarchiser, afin de définir un bien-être profond, bref de faire de sa vie un tout cohérent, intégré, au lieu de ne penser la satisfaction que dans l'accumulation indéfinie de biens… “accumulables” (le terme est moins vague qu'il n'y paraît) et la poursuite d'une série de fins ponctuelles erratiques et anarchiques [161, 366]. Ni un simple animal, ni un être réductible à la seule rationalité de l'optimisation de ses satisfactions, ne résultant que d'incitations ou de stimulations [343-358], voilà bien ce qu'il en est pour de bon. Sachant qu'ordonner une vie, faut-il ajouter, ne signifie donc pas se “priver”, mais se donner une vie comme globalité sensée et non comme vortex de volitions désaccordées ou tonneau des Danaïdes de désirs, trop souvent en concurrence, de par les biens visés, avec ceux des autres.
Ainsi donc, Saint Thomas n'est-il pas, Hirschfeld s'attache bien à le souligner, un adversaire de la dimension matérielle de la réalité humaine, mais un théologien qui se fait fort de la replacer dans une hiérarchie de fins, indexée aussi bien à la nature ou fin de l'homme, qu'à l'origine transcendante de celui-ci. Rendu là, prétendre qu'ancré beaucoup plus qu'on ne le suppose dans son temps, il serait pleinement en phase avec les évidences de notre modernité prétendument “libérale”, il y a là un pas que l'autrice se garde bien de franchir. C'est que le temps de saint Thomas, quand bien même voit-il s'annoncer une économie moderne, est encore loin tout de même de la réalité d'un capitalisme industriel, encore plus d'un capitalisme financier. De même, pour ce qui est de l'organisation du travail, du projet de développement technique et d'arraisonnement de la nature afin de satisfaire au bien-être ou à la volonté de puissance de l'homme, ceux-ci, en son temps, comme plus tard, en celui de Descartes, ne sont-ils pas à même de pouvoir donner clairement une image satisfaisante de leurs implications et de leur bilan véritables. C'est que, concernant les premiers problèmes, la condamnation thomiste de l'usure, du prêt à intérêts, du crédit, non seulement n'est plus guère d'actualité, mais passe à côté de l'aspect indubitablement positif de celui-ci, dès lors qu'il permet à un individu, en-dehors de tout cadre capitaliste nécessaire, de jouir d'un bien avant d'avoir fini d'en régler le montant ou de développer une “affaire”, et veut ignorer que ce type d'activité représente donc un service qui mérite d'une façon ou d'une autre une rémunération. Et est-il vrai que la question du juste prix n'a guère de sens au regard de la logique financière et industrielle aujourd'hui, où la pénurie provoquant l'augmentation du coût d'un bien en situation par exemple de catastrophe naturelle, doit être pensée comme un indicateur précieux et un incitateur pour les producteurs éloignés. Bref, l'injuste en tant que tel, dira-t-on aujourd'hui (le prix plus élevé d'un bien là où on en aurait le plus besoin) aurait-il en fait une “fonction sociale” irrécusable [69, 245, 250-251].
De même, doit-on admettre que Saint Thomas est hors du champ de l'idée centrale d'économie d'aujourd'hui qui veut que le marché en lui-même puisse produire de “l'ordre à partir des choix non-coordonnés de millions ou de milliards de personnes” [75]. Et in fine, qu'il puisse reconnaître, bien plus qu'Aristote, une certaine légitimité du commerce, au service de la collectivité, ne doit-il par rendre aveugle au fait que son jugement est bien trop prudent en l'espèce au regard de l'enthousiasme d'un Adam Smith [260] ou même, par avant, d'un Montchrétien ou émer de Cruce, en leur temps.
Cela étant, force est de dire aussi que l'approche morale de l'Aquinate n'est pas sans consonner avec une certaine inquiétude que même la culture du marché n'a jamais pu totalement effacer de notre sensibilité. Aussi à vouloir la déclarer, sans autre façon, définitivement gentiment niaise ou obsolète, serait-ce bien plutôt là s'exposer à se voir exposer peut-être au reproche de naïveté plus ou moins arrogante.
Prenons, pour exemple sa défiance à l'endroit de cette monnaie, défiance héritée de la pensée d'Aristote, et qui est effectivement, à y regarder de près, une bien étrange réalité [254]. Chose fascinante pour le moins, en effet, que cette richesse artificielle, abstraite et quantitativiste [271-275] déconnectée de toute réalité particulière, promesse de toutes les satisfactions uniquement matérielles, mais qui semble devenir le symbole de l'accessibilité, et la convertibilité indéfinie de toutes les richesses en général, de quelque nature qu'elles puissent être. Et non seulement peut-on dire que la finance a une tendance “naturelle” à se déconnecter de la richesse matérielle réelle, ainsi que des conditions de sa production, mais la monnaie semble-t-elle devenir le modèle de ce à quoi aspire l'homme, une promesse de satisfaction par la consommation, la mise à disposition indéterminée de toute chose, avant même au demeurant de disparaître au profit des flux financiers encore plus “symboliques”. C'est bien là que l'avarice se comprend alors aussi bien que la cupidité, hybris de la quête de la disponibilité idéal de toutes choses [255]. Et nul besoin d'être un moraliste chagrin pour prendre acte que le moyen d'échange des biens matériels est bien devenu en soi, archétype et promesse de toute satisfaction, de même que la rationalité technicienne veut nous faire accroire que de droit tout serait maîtrisable par ses soins. Il y a bien un lien certain entre le consumérisme exacerbée par la monnaie (promesse de l'accès à tout) et la volonté de puissance, exacerbée par la technologie (fantasme du contrôle de tout), entre la cupidité et ce mauvais infini du paradigme technocratique, dénoncé il y a quelques années déjà par le pape François lui-même dans son encyclique Laudate Si de 2015 [275-277].
À la lecture de cet ouvrage, d'aucuns ne laisseront donc pas de se poser la question de la nécessité du religieux comme instance critique des négativités de notre modernité en général, et des présupposés et des finalités de la science économiques en particulier. Loin s'en faut qu'il nous faille trancher ici. Mais toujours est-il que face aux différentes urgences présentes de nos sociétés, est-il bon de rappeler les apports et les alternatives qu'il est donné à la théologie de réaffirmer, et dont ce volume est un bon écho, fût-ce dans un secteur particulier.
D'une part que ce que l'on entend par le terme “rationalité”, et l'on sait combien cette appellation a pu être gage d'émancipation ici et là, dès lorsqu'elle n'est pas une simple arme rhétorique aux services des préjugés installés ou des intérêts du moment, n'est certes, en définitive, pas aussi transparent et univoque que cela. Dans l'immédiat en tout cas, et ce n'est pas Kant qui prétendrait le contraire, nous souviendrons-nous donc que cette rationalité pourrait ou devrait désigner autre chose que ce que l'instrumentalisme ou l'utilitarisme voudrait nous laisser entendre par là. Car de fait la dite rationalité instrumentale, le calcul au service d'une fin quelconque, sanctifiée sous le label de l'utile ou de l'optimisation, peut parfois — l'histoire ne l'a-t-elle que trop souvent montré dans les deux siècles qui viennent de s'écouler— n'être rien d'autre que la mise en place d'une pratique démoniaque, délétère ou absurde sans même l'excuse de la spontanéité, de l'instinct ou d'une passion ponctuelle : et qu'il s'agisse de l'organisation de la production, de la gestion d'une vie, ou de l'extermination d'un peuple. L'urgence est bien là : retrouver, Révélation ou non, le sens d'une raison normative, régulatrice, capable de proposer un monde cohérent, et qui soit autre donc chose qu'une simple faculté au service de fins ponctuelles, passionnelles, aussi indéterminées qu'indéfinies. La raison du siècle des Lumières, en somme, à défaut du logos des grecs de l'Antiquité.
D'autre part, ce que l'on entend par bonheur, ce dont l'économie, de façon plus ou moins crue, fait son objet premier, ne s'identifie sans doute pas totalement ou a priori, c'est peu de le dire, avec l'éthique et l'anthropologie qui amène cette même économie à promouvoir l'évidence d'une croissance indéfinie, ne relevant que des désirs des sujets : des désirs plus ou moins “incités”, exacerbés, orientés, fabriqués par un marché censément n'avoir d'autre noble fonction que de les satisfaire, comme aime à le laisser entendre les “commerciaux” entretenant à l'envi le mythe des exigences propres et premières du consommateur.
Enfin, la justice, telle que saint Thomas l'expose, ne peut que mettre en cause l'idée d'une insularité psychologique de l'être humain, dont la propriété sanctuarisée serait l'objectivation légitime nécessaire et sans restriction en principe assignable. Notre modernité néo-libérale est bien ainsi, dans son refus d'une transcendance normative excédant le marché, montrée du doigt et invitée à rendre des comptes. Et est-ce peut-être là que l'ouvrage de M. Hirschfeld nous laisse d'ailleurs insatisfait pour une part. Car, par-delà cette compossibilité entre thomisme et libéralisme qu'elle s'empresse un peu trop parfois d'établir ou de présupposer, à l'intersection de la science économique et de la théologie, devrait aussi se poser la question des “libertés” que l'on prétend garantir à l'homme : soit au nom de la dynamique de la production, soit au nom d'une culture de la responsabilité et de la possibilité d'une réelle culpabilité, soit au nom du type de cohésion que l'on veut obtenir dans les sociétés. à tout prendre, est-il curieux de voir combien ceux qui se font les chantres du privé, de l'actionnariat, de l'individu indépendant et idéalement “premier de cordée” se défiant de toute politique économique jugée trop “socialiste” ou “collectiviste” retrouve la réalité de l'interdépendance de fait de tous, dès lors qu'il s'agit de restreindre les libertés à l'occasion des crises qui scandent notre actualité. Et de voir soudain combien ainsi une propagande gouvernementale dite démocratique découvrant “l'interdépendance” physique et morale, peut tourner aisément à un holisme dont la société chinoise ne peut alors apparaître que comme la forme pleinement adéquate.
Enfin, et plus fondamentalement, cet ouvrage sait-il attirer notre attention sur le fait qu'en amont de ces questions de la raison, du bonheur et de la justice, voire de la liberté, est-ce bien celle de l'homme et de l'humanité elle-même qui est bien loin d'être réglée une fois pour toutes. Devrait-il être ainsi évident que l'on ne saurait impunément se débarrasser trop rapidement du concept de téléologie, de finalité, de l'idée d'une fin de l'homme, ne serait-ce que parce qu'en fait, la biologie elle-même, pour le vivant en général ne saurait s'en dispenser pour penser son objet [147-148], et aussi bien parce que la “neuro-économie” qui dans la droite ligne du développement des neuro-sciences, dessine bien un écart entre la satisfaction que recherche le sujet et le gain véritable de bien-être qu'il en obtiendra véritablement, au risque d'ailleurs d'un paternalisme ou libéralisme autoritaire [110-113]. Bref, penser que l'homme est cet être qui n'est appelé qu'à se laisser guider uniquement par l'ordre de ses désirs et satisfactions immédiates, par son “ressenti” pour obtenir le maximum de satisfaction est sans doute d'une grande naïveté, sinon d'une grande pauvreté, pour ne pas dire dangerosité, d'un point de vue humaniste. Quand il ne s'agit pas là simplement d'une simple propagande consumériste assez parallèle parfois à celle qui voudrait que l'homme n'a vocation qu'à s'adapter à tel ou tel environnement, nous donnant alors à entendre que l'homme a atteint sa fin, uniquement dans l'instant de sa satisfaction et en développant au maximum sa plasticité adaptative sans s'inquiéter d'une nature véritable plus profonde qui pourrait ainsi être bafouée ou ignorée. D'aucuns n'auront pas manqué de reconnaître ici les deux idées fondamentales d'une certaine morale ou propagande, et que propagent avec complaisance aussi bien le marché, le managérialisme rampant de la politique d'aujourd'hui, que le transhumanisme, ou la Great Reset si chère à Klaus Schwab et aux GAFAM. Dissoudre la pertinence même de l'idée d'aliénation pour favoriser le consumérisme ou l'hédonisme, la soumission et l'intégration aux dites évidences sociétales d'aujourd'hui, à une culture d'entreprise, aux nécessités proclamées comme telles, ou céder aux sirènes de l'aventure indéfinie de la volonté de puissance, voilà bien le programme grand public du prêt-à-penser d'aujourd'hui. On peut ne pas être d'accord avec la vision de l'homme que nous dispense saint Thomas, certes, et c'est peu de le dire, mais rappeler que l'homme peut passer à côté de sa perfection, de son authenticité, en se soumettant à telle séduction, tentation ou sollicitation du moment, à tel intérêt bien calculé, à tel pouvoir humain tutélaire, à telle panique sanitaire ou sécuritaire, n'en reste pas moins des plus salutaires. Et ce ne sont certes pas les démocraties d'aujourd'hui en pleine errance idéologique, mélangeant allègrement revendication narcissique et émancipation véritable, individualisme éthique et égoïsme sociétal, sans vouloir ou savoir les différencier, qui peuvent se dispenser de regarder avec dédain des discours alternatifs, au fond peut-être guère plus dogmatiques que les siens, et à tout le moins parfois bien moins opportunistes, et très souvent beaucoup moins sommaires dans leurs analyses. En tout état de cause, serait-ce peut-être même la grandeur d'une démocratie que de ne pas trop s'empresser de se régler ou de se mettre à la remorque d'un certain paradigme économiste, aussi incertain d'un point de vue épistémologique, pour ce qui est de l'idée de l'homme qu'elle peut prétendre défendre ou promouvoir [373].
Un ouvrage qui n'apportera pas grand-chose à l'économiste réellement cultivé, soucieux donc de s'interroger sur les limites de sa discipline, non plus qu'au théologien soucieux d'articuler sa connaissance de saint Thomas avec les défis éthiques, sociaux et politiques d'aujourd'hui. Ceux qui ne sont ni économistes ni ecclésiastiques de profession ou de vocation, en revanche, auront-ils le sentiment justifié d'un livre instruit, suggestif, et qui nous invite sérieusement à nous interroger sur certaines évidences du moment telles que les grands médias ont l'art de propager, ressasser, ânonner, avec une innocence ou d'une arrogance qui confine parfois au risible, et aussi bien de nous défier d'une autre évidence : celle de l'obsolescence de certaines œuvres. Ce n'est tout de même pas rien. Que Mary Hirschfeld ne veuille, ne puisse ou ne sache pas exploiter tout le potentiel éthique, voire politique, indéniablement et en tout état de cause disruptif de la pensée thomiste, au regard du paradigme ou de la dogmatique d'aujourd'hui, peut donner lieu à quelques regrets. Mais elle ne serait pas la première, en la matière, à céder à la tentation d'un accomodement un peu trop patelin.
© 2021 Bruno Hueber & GRAAT On-Line